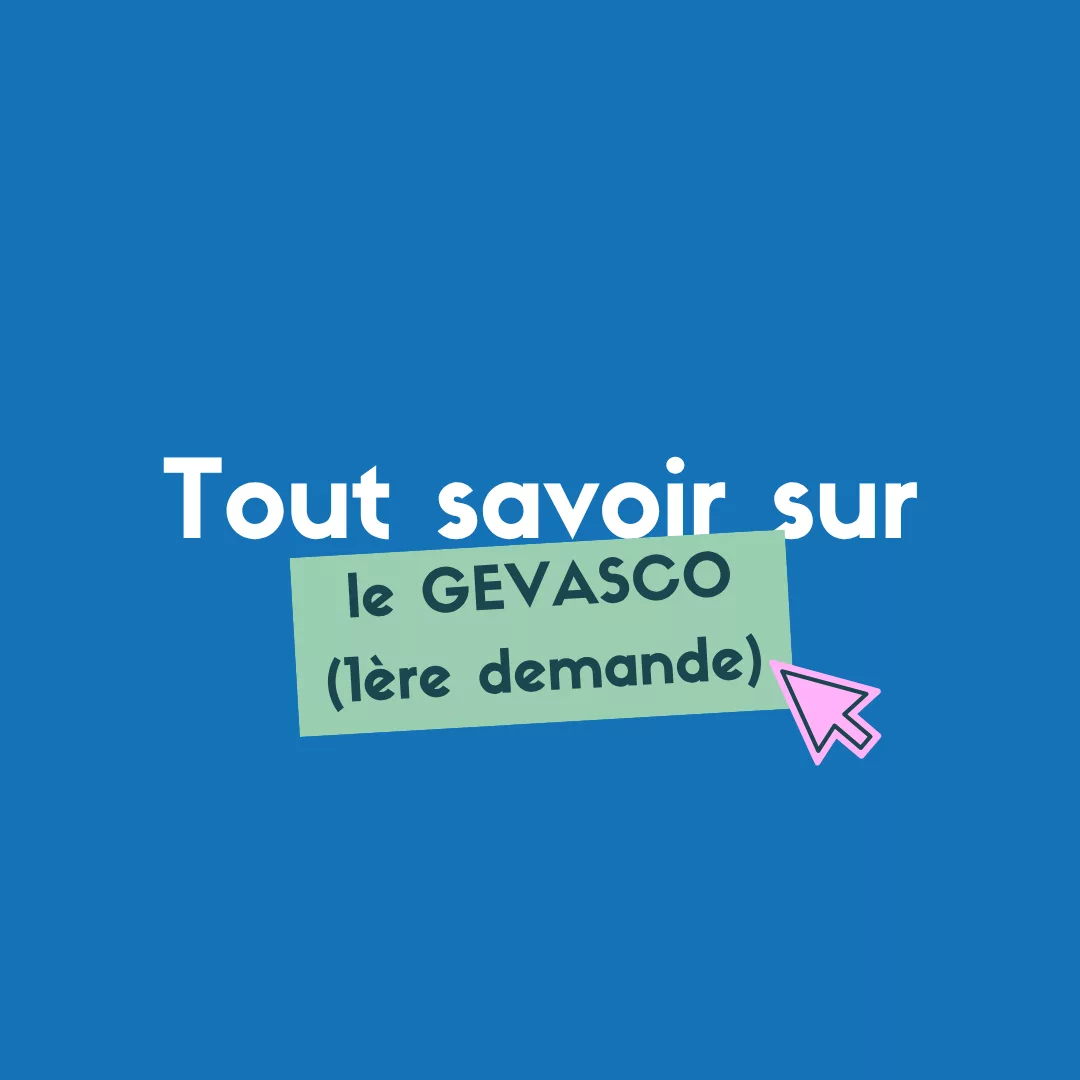Dans cet article, vous découvrirez les différents dispositifs de scolarisation proposés en France pour les enfants à besoins particuliers : PAI, PAP, PPS et PPRE.
Nous verrons à qui ils s’adressent, comment les mettre en place, quelles démarches effectuer et comment choisir le plus adapté à la situation de votre enfant.
Des exemples concrets, des témoignages de parents et des sources officielles viendront éclairer chaque section pour vous guider pas à pas.

Sommaire
Dispositif scolaire : définition et rôle en 2025
PAI, PAP, PPS, PPRE : le casse-tête des parents
Le vocabulaire de l’école inclusive peut vite semer la confusion. PAI, PAP, PPS, PPRE… chaque acronyme correspond à une situation précise : santé, troubles des apprentissages, handicap reconnu ou difficultés passagères. Pas étonnant que de nombreux parents se sentent perdus.
Pourtant, ces dispositifs ont un rôle commun : adapter l’école aux besoins de l’enfant. Leur objectif est de garantir que chaque élève puisse progresser, malgré ses difficultés. Comprendre leurs différences est donc essentiel pour choisir le bon accompagnement.
À la rentrée 2024, plus de 490 000 élèves en situation de handicap étaient scolarisés en milieu ordinaire (Ministère de l’Éducation nationale). Ce chiffre illustre l’ampleur de l’inclusion scolaire en France.
L’école inclusive en chiffres 2024-2025
Selon la DREES, 235 400 élèves avec un PPS sont scolarisés dans le premier degré et 232 900 dans le second. Ces chiffres confirment le rôle central du PPS dans le parcours des enfants handicapés.
Les moyens humains progressent aussi. Plus de 132 000 AESH accompagnent désormais les élèves en situation de handicap. Leur présence est déterminante pour éviter l’isolement et favoriser la réussite.
Les outils numériques prennent leur place : déjà 308 568 livrets de parcours inclusif ont été ouverts. Ils facilitent le suivi entre enseignants, familles et institutions.
Enfin, près de 11 000 ULIS accueillent des élèves aux besoins spécifiques tout en les maintenant intégrés dans leur établissement. L’école inclusive est donc une réalité concrète qui touche des centaines de milliers de familles.
Tableau comparatif des dispositifs scolaires
Avant de rentrer dans les détails de chaque plan, voici une vue d’ensemble. Le tableau ci-dessous résume les différences essentielles entre le PPRE, le PAI, le PAP et le PPS.
Ce comparatif permet de gagner du temps et de mieux orienter les démarches.
Tableau comparatif des dispositifs scolaires
| Dispositif | Public concerné | Durée | Validation | Démarche MDPH |
|---|---|---|---|---|
| PPRE | Difficultés scolaires temporaires | Courte (quelques mois) | Équipe pédagogique | ❌ Non |
| PAI | Problèmes de santé chroniques (allergies, asthme, diabète…) | Année scolaire | Médecin scolaire | ❌ Non |
| PAP | Troubles des apprentissages (dys, TDAH…) | Long terme (jusqu’au lycée) | Médecin Éducation nationale | ❌ Non |
| PPS | Handicap reconnu par la MDPH | 1 à 5 ans | CDAPH | ✅ Obligatoire |
| PIA | Élèves scolarisés en établissements médico-sociaux (IME, ITEP, SESSAD) | Variable selon le projet | Directeur de l’établissement médico-social | ✅ Déclinaison du PPS |
Schéma décisionnel : quel dispositif scolaire pour mon enfant ?
Face aux difficultés scolaires ou de santé de leur enfant, les parents se demandent souvent quel plan demander. Le schéma ci-dessous aide à s’orienter pas à pas.
Schéma décisionnel : Quel dispositif pour mon enfant ?
Mon enfant a des difficultés scolaires ?
Si oui, distinguer difficultés temporaires et troubles durables.
Difficultés temporaires
Lacunes ponctuelles, déménagement, absence longue, redoublement.
Difficultés durables liées à un trouble
Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, TDAH, autres troubles des apprentissages.
Mon enfant a un problème de santé chronique ?
Allergies, asthme, diabète, épilepsie, etc.
Mon enfant a un handicap reconnu par la MDPH ?
Décision CDAPH. Possibilité d’AESH, matériel adapté, ULIS.
Mon enfant est scolarisé en établissement médico-social ?
IME, ITEP, SESSAD : accompagnement spécifique en lien avec le PPS.
Cumul possible selon les besoins
Exemples : PAP + PAI (dys + diabète) ; PPS + PAI (handicap + allergie sévère).
PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Éducative
Définition et objectifs
Le PPRE est un dispositif de l’Éducation nationale destiné aux élèves qui rencontrent des difficultés scolaires temporaires. Contrairement au PAP (troubles des apprentissages) ou au PPS (handicap reconnu par la MDPH), il ne concerne pas les situations durables mais les retards ponctuels. Son but est de prévenir le décrochage scolaire en proposant des objectifs clairs et un soutien adapté sur une durée courte.
Il peut être mis en place à tout moment de l’année, directement par l’équipe enseignante, sans passer par la MDPH. Depuis la circulaire de 2019, le PPRE est même obligatoire lorsqu’un redoublement est décidé. En 2025, dans un contexte où plus de 520 600 élèves en situation de handicap sont déjà scolarisés en milieu ordinaire (Éducation nationale), le PPRE joue un rôle clé pour les enfants qui n’ont pas besoin d’un plan lourd mais d’un accompagnement ponctuel.
Mise en œuvre et témoignage
Le PPRE est proposé par l’enseignant après observation des difficultés, puis validé par le directeur d’école. Les parents sont associés dès le départ, car leur accord et leur soutien sont essentiels à la réussite. Le plan peut être consigné dans le Livret de Parcours Inclusif (LPI), utilisé dans plus de 308 000 cas en 2024-2025 (Éducation nationale), afin d’assurer un suivi clair entre familles et enseignants.
Témoignage : « Mon fils Théo avait pris du retard après un déménagement. L’école a mis en place un PPRE de deux mois, avec quelques heures de soutien chaque semaine. Il a rapidement retrouvé son niveau. Ce dispositif nous a rassurés car il est simple, efficace et sans démarches compliquées. » – Céline, maman d’un élève de CE2.
PAI : Projet d’Accueil Individualisé

Le PAI pour les problèmes de santé à l’école
Le PAI (Projet d’Accueil Individualisé) s’adresse aux enfants présentant des troubles de santé chroniques comme les allergies alimentaires, l’asthme, le diabète ou l’épilepsie.
C’est un document officiel qui définit les aménagements nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être de l’élève dans l’établissement.
Selon Service-Public.fr, il précise les adaptations de la vie scolaire, les gestes d’urgence et les soins à prévoir.
Le médecin scolaire valide obligatoirement le PAI. Sa signature engage la responsabilité de l’établissement et assure que tous les encadrants connaissent la conduite à tenir.
À la rentrée 2024, environ 100 000 élèves bénéficiaient d’un PAI selon le ministère de l’Éducation nationale.
Le dispositif peut concerner aussi bien le temps scolaire que périscolaire et permettre des aménagements comme des horaires adaptés ou des dispenses d’activités.
Cas pratique : Emma, 6 ans, allergie sévère aux arachides
Situation : Emma risque un choc anaphylactique au contact des arachides.
Solution PAI : Mise en place d’une trousse d’urgence avec injection d’adrénaline, éviction alimentaire stricte, formation du personnel.
Protocole : Repas sécurisés, table dédiée à la cantine, surveillance renforcée en récréation.
Résultat : L’école est préparée à réagir immédiatement, ce qui rassure la famille et garantit la sécurité d’Emma.
Principales pathologies couvertes par un PAI
Les allergies alimentaires représentent la majorité des PAI, notamment pour les arachides, les œufs, le lait ou les fruits à coque.
Selon le ministère, l’asthme et les allergies constituent environ 63 % des demandes de PAI. Le dispositif permet l’utilisation d’inhalateurs en cas de crise, même en l’absence d’infirmière.
Les pathologies chroniques comme le diabète de type 1 nécessitent aussi un protocole précis de surveillance glycémique et de prise en charge.
En cas d’allergies sévères, une trousse d’urgence est fournie par les parents, comprenant généralement un stylo d’adrénaline.
Les protocoles sont validés par la Société Pédiatrique de Pneumologie et Allergologie afin de garantir la conformité médicale.
Enfin, l’épilepsie figure parmi les pathologies fréquemment couvertes par un PAI, avec des gestes adaptés détaillés par le médecin traitant ou le pédiatre.vertes par un PAI, avec des gestes adaptés détaillés par le médecin traitant ou le pédiatre.
PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé
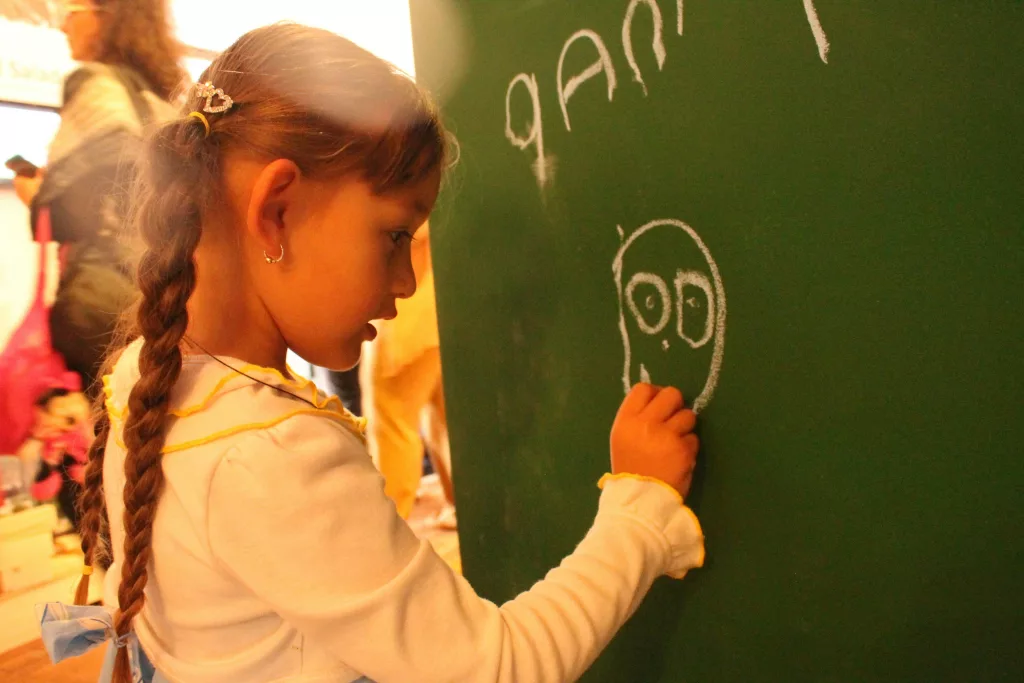
Le PAP pour les troubles dys
Le PAP s’adresse aux élèves avec des troubles des apprentissages : dyslexie, dyspraxie, dysphasie, TDAH…
Il répond aux besoins des élèves qui connaissent des difficultés scolaires durables selon Éduscol.
Contrairement au PPRE qui est ponctuel, le PAP est un dispositif de long terme renouvelable chaque année.
Aucune reconnaissance MDPH n’est nécessaire, le PAP reste un dispositif interne à l’établissement.
Le PAP suit l’élève de l’école jusqu’au lycée et ne relève pas de la MDPH selon l’Onisep.
Il s’adresse aux élèves du 1er et 2nd degrés présentant des troubles neurodéveloppementaux.
Créé à la demande des associations de parents d’enfants dyslexiques via la FFDys, le PAP existe depuis 2015.
Il permet aux élèves de bénéficier d’aménagements pédagogiques spécifiques à leurs troubles.
Cas pratique : Sarah, 11 ans, dyslexie et dysorthographie
Situation : Sarah confond les lettres, écrit lentement et fait beaucoup de fautes.
Solution PAP : Ordinateur en classe, temps majoré +1/3, textes agrandis, police adaptée.
Évaluations : Lecture des consignes par l’enseignant, fautes d’orthographe non comptées.
Résultat : Sarah peut montrer ses vraies compétences sans être pénalisée par ses troubles.
Aménagements possibles avec le PAP
Le PAP propose des adaptations pédagogiques sans changer les objectifs d’apprentissage.
Temps majoré aux évaluations, police de caractères agrandie, usage de l’ordinateur font partie des aménagements.
Le droit d’utiliser le matériel informatique de l’établissement ou son propre matériel est fréquent.
Les évaluations adaptées permettent de ne pas sanctionner les fautes d’orthographe pour un dyslexique.
Un emploi du temps adapté permet la prise en charge extérieure par un orthophoniste sur temps scolaire selon Mon Parcours Handicap.
Les aménagements portent sur l’accessibilité des apprentissages : allègement du travail, polycopiés, captations audio.
Le PAP peut prévoir des dispenses partielles d’activités incompatibles avec les troubles.
Des activités de substitution sont alors proposées à l’élève concerné.
PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation
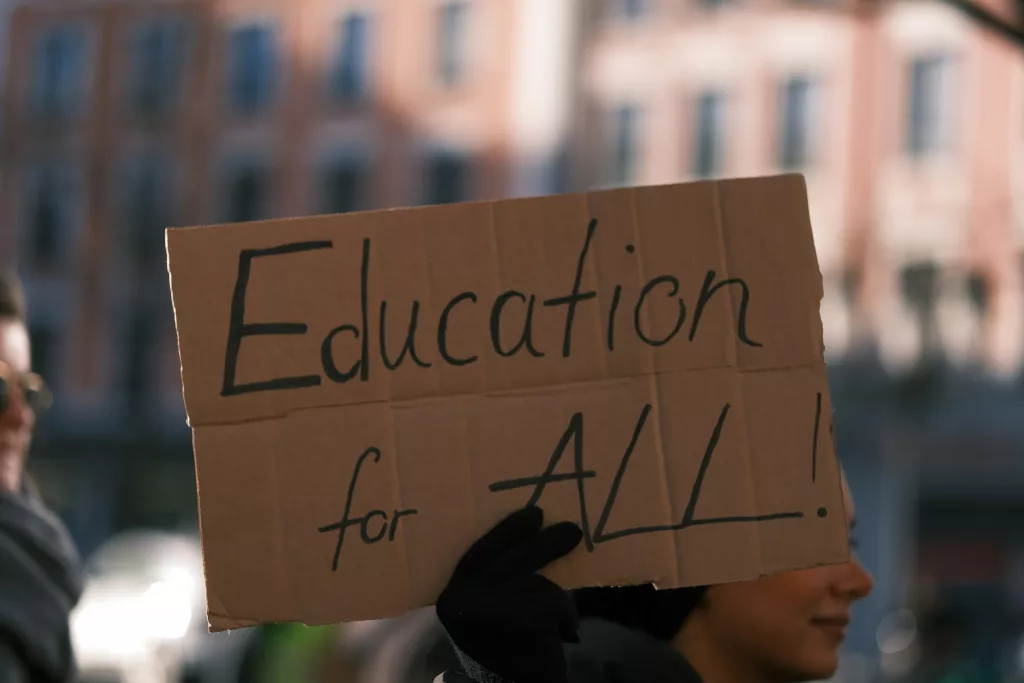
Le PPS, dispositif central du handicap
Le PPS concerne uniquement les élèves reconnus handicapés par la MDPH sur décision de la CDAPH.
C’est le dispositif le plus complet de l’école inclusive selon Mon Parcours Handicap.
Le PPS organise le déroulement de la scolarité et assure la cohérence des accompagnements.
Il constitue une composante du plan personnalisé de compensation élaboré par la MDPH.
La Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH) décide de sa mise en place.
Sans cette reconnaissance officielle de handicap, aucun PPS n’est possible.
Le PPS permet d’assurer la continuité du parcours scolaire de chaque élève handicapé de 3 à 20 ans.
Il s’impose à tous les établissements scolaires, sanitaires et médico-sociaux.
Cas pratique : Antoine, 7 ans, autisme avec troubles associés
Situation : Antoine a des difficultés de communication et des comportements répétitifs.
Solution PPS : AESH 20h/semaine, pictogrammes, pause en salle calme, ULIS partiel.
Matériel : Tablette de communication, casque anti-bruit, planning visuel.
Suivi : Enseignant référent, équipe de suivi annuelle, adaptation continue des besoins.
Que contient le PPS ?
Le PPS peut prévoir un accompagnement humain AESH, du matériel pédagogique adapté, une orientation en ULIS.
Il définit les modalités de scolarisation et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives nécessaires selon l’Onisep.
Types d’aménagements : orientation, accompagnement humain, aménagements pédagogiques, attribution de matériels adaptés.
Il précise les modalités de scolarisation : classe ordinaire, ULIS, établissement spécialisé ou mixte.
Le PPS peut également prévoir des dispenses d’enseignement quand un cours ne peut être adapté.
Des aménagements de la scolarité comme le temps partiel ou l’adaptation des apprentissages sont possibles.
Une aide par un Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) peut être notifiée.
Le document précise les mesures d’accompagnement nécessaires au confort quotidien de l’élève.
Démarches pour obtenir un PPS
La famille fait une demande auprès de la MDPH de son département avec le formulaire Cerfa n° 1569201.
Un certificat médical Cerfa n° 1569501 accompagne obligatoirement la demande selon Service-Public.fr.
L’enseignant référent accompagne la constitution du dossier et fait le lien avec la MDPH.
Le Guide d’EVAluation (GEVA-Sco) permet d’analyser la situation et les besoins de l’élève.
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH évalue la situation grâce au GEVA-Sco rempli par l’équipe éducative.
Elle élabore une proposition de PPS transmise à la CDAPH pour décision finale.
Les parents ont 15 jours pour faire des observations avant validation définitive.
Le PPS est transmis à l’enseignant référent chargé de sa mise en œuvre et de son suivi.
PIA : Plan Individuel d’Accompagnement

Le PIA dans les établissements médico-sociaux
Le PIA concerne les enfants scolarisés dans des établissements médico-sociaux comme les IME, SESSAD, ITEP ou IEM.
Il constitue l’outil de mise en œuvre du PPS dans ces structures spécialisées selon Wikiversité.
Ce document personnalisé définit les modalités de l’accompagnement pédagogique, éducatif et thérapeutique.
Il décline concrètement comment vont s’appliquer les mesures prévues dans le PPS.
Le PIA est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité du directeur de l’établissement médico-social selon l’article D312-10-3 du CASF.
Il doit être en cohérence avec le plan personnalisé de compensation de chaque enfant.
Pour les ITEP, on parle de PPA (Projet Personnalisé d’Accompagnement) qui est l’équivalent du PIA.
La famille est obligatoirement associée à son élaboration, mise en œuvre et évaluation.
Les établissements concernés par le PIA
IME (Instituts Médico-Éducatifs) : Accueillent des enfants avec déficience intellectuelle nécessitant une éducation spécialisée.
Plus de 50% des établissements médico-sociaux sont des IME selon l’académie de Bordeaux.
Ils comprennent souvent une SEES pour les plus jeunes et une SIPFP pour la formation professionnelle.
L’axe scolaire vise le développement d’une autonomie maximale et l’insertion future.
ITEP (Instituts Thérapeutiques, Éducatifs et Pédagogiques) : Accueillent des jeunes de 12 à 20 ans avec troubles du comportement.
Ils dispensent soins et rééducations tout en favorisant le maintien du lien familial.
L’objectif est de promouvoir l’intégration et préparer l’accueil en milieu scolaire ordinaire.
Le PPA remplace le PIA dans ces établissements depuis la circulaire de 2007.
SESSAD (Services d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile) : Services ambulatoires maintenant les enfants en milieu ordinaire.
Ils sont souvent adossés aux IME ou ITEP pour un accompagnement à domicile.
Les SESSAD mettent en œuvre des prises en charge qui complètent la scolarisation ordinaire.
Ils portent différentes dénominations selon le handicap : SAFEP, SSEFIS, SAAAIS…
Cas pratique : Maxime, 10 ans, déficience intellectuelle en IME
Situation : Maxime a une déficience intellectuelle légère avec retard dans tous les apprentissages.
Solution PIA : Scolarité adaptée 15h/semaine, orthophonie 2h, psychomotricité 1h, soutien éducatif.
Objectifs annuels : Apprentissage lecture syllabique, autonomie repas, socialisation groupe.
Partenariat : Liaison avec école ordinaire pour inclusion progressive en sport et arts plastiques.
Les trois axes du PIA
Axe pédagogique : Définit les méthodes et pratiques d’enseignement adaptées aux besoins de l’enfant.
Outils de communication, adaptations scolaires, aménagements spécifiques sont détaillés.
L’enseignant spécialisé coordonne cet axe en lien avec l’équipe pluridisciplinaire.
Les objectifs scolaires sont définis en référence aux programmes officiels adaptés.
Axe éducatif : Développe l’autonomie, la personnalité et les relations sociales de l’enfant.
Actions pour l’ouverture à de nouvelles expériences et l’apprentissage de la vie quotidienne.
Travail sur les comportements, la gestion des émotions et l’insertion sociale.
Préparation progressive à l’autonomie et à l’insertion professionnelle future.
Axe thérapeutique : Organise les rééducations et le suivi psychologique nécessaires.
Séances individuelles ou en groupe selon les besoins : orthophonie, psychomotricité, kinésithérapie.
Suivi médical régulier et coordonné avec les professionnels extérieurs.
Adaptation des soins en fonction de l’évolution de l’enfant et de ses progrès.
Élaboration et suivi du PIA
Le PIA comporte l’évaluation de l’accompagnement réalisé l’année précédente selon Enfant différent.
Il définit les priorités et objectifs sur l’année à venir pour chaque axe.
Les attentes du jeune et de sa famille sont intégrées dans le projet.
Le document précise les moyens, méthodes et pratiques à mettre en œuvre.
La famille reçoit des informations détaillées au moins tous les semestres sur l’évolution de l’enfant.
Une évaluation annuelle permet d’ajuster les objectifs et les moyens.
Le PIA s’articule avec le PPS et respecte les décisions de la CDAPH.
L’enseignant référent participe au suivi et assure la liaison avec l’équipe de suivi de scolarisation.
Intégration avec le PPS
Le PPS constitue le volet scolaire du PIA selon l’Onisep.
L’établissement médico-social est tenu de mettre en application les décisions de la CDAPH.
Le PIA ne peut être complètement élaboré qu’en partenariat avec l’école de référence.
L’enseignant référent contrôle la cohérence entre le PIA et les orientations du PPS.
Pour les enfants en inclusion partielle, le PIA organise les temps partagés entre l’établissement et l’école ordinaire.
Il définit les modalités de coopération et de transmission d’informations.
Les objectifs pédagogiques doivent être cohérents entre les deux structures.
L’équipe de suivi de scolarisation évalue régulièrement cette articulation.
Conclusion : Accompagner la réussite de chaque enfant

Les différents dispositifs scolaires – PPRE, PAI, PAP et PPS – sont autant d’outils pour répondre aux besoins spécifiques des élèves. Ils couvrent des réalités très diverses : difficultés passagères, troubles de santé, troubles des apprentissages ou handicap reconnu par la MDPH.
L’avantage est qu’ils peuvent s’articuler et évoluer au fil du parcours de l’enfant, garantissant un accompagnement personnalisé. En 2025, l’école inclusive n’est plus une simple promesse : elle s’appuie sur des moyens concrets, humains et numériques (AESH, Livret Parcours Inclusif, ULIS, etc.) pour offrir à chaque élève la possibilité de progresser.
En tant que parents, il est essentiel de connaître ces dispositifs et leurs démarches, afin de demander l’aide la plus adaptée. Plus que des sigles administratifs, ce sont de véritables leviers pour la réussite scolaire et l’épanouissement des enfants.
Démarches et contacts essentiels
Repères rapides pour lancer la bonne démarche selon le dispositif, puis retrouver les interlocuteurs utiles.
| Dispositif | Qui contacter | Démarche / Pièces | Validation / Décision |
|---|---|---|---|
| PPRE sans MDPH | Enseignant(e) / Directeur(trice) d’école | Signalement des difficultés, échange famille–équipe pédagogique. Aucune formalité administrative spécifique. | Équipe pédagogique (mise en place possible à tout moment). |
| PAI santé | Médecin scolaire (via l’établissement) | Rendez-vous + certificat du médecin traitant/pédiatre. Organisation des gestes d’urgence et aménagements. | Médecin scolaire (signature obligatoire). |
| PAP troubles dys | Équipe pédagogique / Direction | Demande auprès de l’établissement. Constat médical des troubles (médecin Éducation nationale). | Médecin de l’Éducation nationale. |
| PPS MDPH | MDPH (via Enseignant référent) | Dossier MDPH complet + certificat médical. Accompagnement par l’enseignant référent. | CDAPH (décision officielle). |
Numéro vert Information École inclusive : 0 805 805 110 (gratuit, du lundi au vendredi)
| Contact | Où trouver | Utilité |
|---|---|---|
| MDPH de votre département | Annuaire Mon Parcours Handicap | Dossier PPS, aides, droits, orientation. Point d’entrée pour la CDAPH. |
| Enseignant référent handicap | Coordonnées via l’Inspection académique / établissement | Suivi du PPS, lien avec MDPH, organisation des équipes de suivi. |
| Médecin scolaire | Secrétariat de l’établissement | Validation PAI, avis médical PAP, prévention et protocoles santé. |
| Associations de parents | FFDys · UNAPEI | Information, entraide, accompagnement dans les démarches. |
FAQ – PAI, PAP, PPS, PPRE
Quelle est la différence entre PAI, PAP, PPS et PPRE ?
Chaque dispositif répond à une situation précise : le PAI pour les problèmes de santé, le PAP pour les troubles des apprentissages, le PPS pour le handicap reconnu par la MDPH et le PPRE pour les difficultés scolaires temporaires.
Quel plan pour quel élève ?
Le choix dépend du profil : un enfant allergique relèvera d’un PAI, un élève dyslexique d’un PAP, et un élève handicapé reconnu par la MDPH aura un PPS.
Comment demander un PAI, un PAP ou un PPS ?
Le PAI s’obtient via le médecin scolaire, le PAP par l’équipe pédagogique avec validation médicale, et le PPS après dépôt d’un dossier à la MDPH.
Qui décide de la mise en place d’un PAP ou d’un PPS ?
Le PAP est validé par le médecin de l’Éducation nationale, tandis que le PPS est décidé par la CDAPH après évaluation de la MDPH.
Peut-on cumuler plusieurs dispositifs (PAI, PAP, PPS, PPRE) ?
Oui, un enfant peut bénéficier de plusieurs dispositifs complémentaires si nécessaire. L’essentiel est que les aides restent cohérentes et adaptées.
Combien de temps pour obtenir un PPS ?
Le délai moyen varie de 3 à 6 mois, selon les départements. La famille reçoit un accusé de réception dans les deux semaines suivant le dépôt du dossier.
Ressources officielles 2025
Sites gouvernementaux vérifiés
| Ressource | Description | Lien |
|---|---|---|
| Mon Parcours Handicap | Plateforme officielle du gouvernement : informations complètes sur PAI, PAP, PPRE, PPS et démarches MDPH. | monparcourshandicap.gouv.fr/scolarite |
| Éduscol (Ministère) | Ressources pédagogiques, textes officiels et fiches pratiques sur l’école inclusive. | eduscol.education.fr |
| Service-Public.fr | Démarches administratives et procédures détaillées pour les familles. | service-public.fr/particuliers |
Applications 2025
| Application | Utilité | Lien |
|---|---|---|
| Livret Parcours Inclusif (LPI) | Application ministérielle pour centraliser PPRE, PAP, PAI, PPS et suivre les aménagements. | Présentation sur Éduscol |
| Mon Parcours Handicap (mobile) | Accès aux démarches MDPH en ligne, informations et suivi des droits. | monparcourshandicap.gouv.fr |
Textes de référence
| Texte | Objet | Lien |
|---|---|---|
| Loi du 11 février 2005 | Égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées. | legifrance.gouv.fr |
| Circulaire 2015-016 | Plan d’accompagnement personnalisé pour les troubles des apprentissages (PAP). | BOEN – MENE1501296C |
| Code de l’éducation – D.351-4 à D.351-9 | Parcours de formation des élèves présentant un handicap et modalités d’aménagement. | legifrance.gouv.fr – Code de l’éducation |