Le rapport « Regards sur l’éducation 2025« de l’OCDE, publié le 9 septembre 2025, dresse un constat alarmant sur l’état de l’enseignement français. Malgré une démocratisation apparente avec 53% de jeunes diplômés du supérieur, la France fait face à un paradoxe troublant : des adultes ayant passé des années sur les bancs de l’école n’ont même pas les compétences d’un enfant de 10 ans.
Cette situation révèle les dysfonctionnements profonds d’un système éducatif qui privilégie la quantité au détriment de la qualité. Entre rupture famille-école, obsession de la vitesse et perte du sens des apprentissages, l’école française traverse une crise majeure qui interroge notre vision de l’éducation.
À travers les données officielles et le témoignage d’une mère soucieuse de transmettre les vraies valeurs éducatives à sa fille, cet article explore les racines du mal et esquisse des pistes pour redonner du sens à l’apprentissage.
Sommaire
L’enseignement français face au paradoxe éducatif
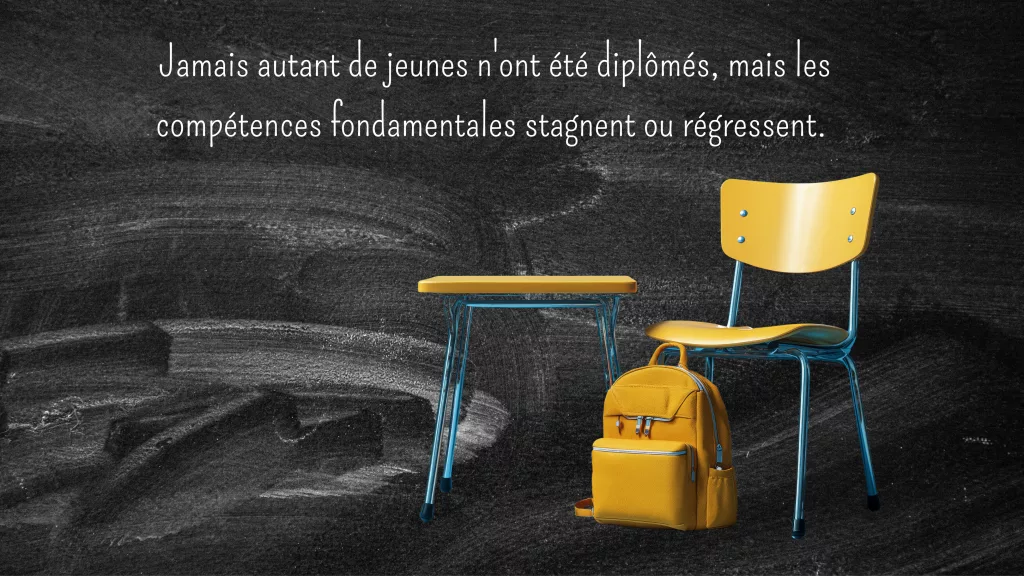
Explosion des diplômes, stagnation des compétences réelles
Le rapport OCDE 2025 révèle un paradoxe saisissant : jamais autant de jeunes n’ont été diplômés, mais les compétences fondamentales stagnent ou régressent. 48% des jeunes adultes des pays OCDE sont aujourd’hui diplômés de l’enseignement supérieur, contre seulement 27% en 2000. En France, cette proportion atteint même 53%, soit une hausse de 5 points depuis 2019.
Cette inflation diplômante masque une réalité préoccupante. Les entreprises peinent à trouver les qualifications recherchées, avec 40% des employeurs en état de pénurie de compétences. Le diplôme est devenu un sésame déconnecté des compétences réelles, créant une génération de « faux diplômés » aux bases fragiles.
L’OCDE pointe notamment les défaillances en littératie et numératie. Ces compétences fondamentales, socle de tout apprentissage, ont stagné voire diminué dans la plupart des pays membres au cours de la dernière décennie. Un constat qui interroge l’efficacité des méthodes pédagogiques actuelles.
Le cas français : des diplômés sans bases solides selon l’OCDE
La France illustre parfaitement ce décrochage entre diplômes et compétences. 30% des adultes français (25-64 ans) n’ont pas le niveau de lecture d’un élève de primaire, contre 28% en moyenne OCDE. Plus alarmant encore, 65% de la population française possède un niveau en français égal ou inférieur à un élève de 6e.
En mathématiques, le constat est similaire : 27% de la population française possède un niveau inférieur ou égal à celui d’un élève de primaire, contre 24% en moyenne OCDE. Ces chiffres illustrent l’ampleur du décalage entre formation et maîtrise effective.
Andreas Schleicher, directeur du département d’Éducation de l’OCDE, résume brutalement la situation : « En France, il y a des adultes qui ont passé des années à l’école et parfois à l’université et qui n’ont même pas les compétences en littératie d’un enfant de 10 ans ». Une phrase choc qui révèle l’échec d’un système focalisé sur la validation plutôt que sur l’apprentissage.
Cette situation s’explique en partie par une approche pédagogique privilégiant la rapidité au détriment de la profondeur. Comme le souligne une mère de famille inquiète : « Si vous faites cuire un poulet une heure à 1000 degrés versus trois heures à 180 degrés, le second sera bien meilleur ». Notre système éducatif ressemble trop souvent à cette cuisson express qui carbonise l’extérieur mais laisse l’intérieur cru.
Les dysfonctionnements majeurs de l’école française

Rupture entre familles et enseignants : une fracture profonde
L’un des maux profonds de l’école française réside dans la rupture de confiance entre familles et enseignants. Là où devrait régner une collaboration harmonieuse autour de l’enfant, s’est installée une méfiance mutuelle destructrice. D’un côté, des enseignants épuisés qui ont perdu confiance en leur mission, pressés par des programmes et des évaluations. De l’autre, des parents sur la défensive, prompts à contester toute remarque sur leur enfant.
Cette guerre larvée a des conséquences dramatiques sur l’apprentissage. Au lieu d’être unis dans un objectif commun, adultes et institutions se renvoient la responsabilité des échecs. Un enseignant qui donne une mauvaise note craint désormais les répercussions parentales. Un parent qui entend que son enfant a des difficultés se braque immédiatement.
Le rapport OCDE pointe d’ailleurs la crise du métier enseignant en France. 39% des enseignants du secondaire ont plus de 50 ans, traduisant un vieillissement préoccupant du corps professoral. Entre 2015 et 2024, les salaires n’ont progressé que de 8% pour les débutants contre 16-17% en moyenne OCDE. Pour les enseignants expérimentés, la stagnation est encore plus criante : +1% seulement dans le primaire contre +4-6% en moyenne OCDE.
Cette dégradation des conditions pousse vers une médicalisation excessive des difficultés scolaires. Plutôt que de prendre le temps de comprendre un enfant différent, on préfère l’orienter vers un spécialiste. C’est plus rapide, mais est-ce vraiment dans l’intérêt de l’enfant ? Parfois, il suffirait simplement de plus d’amour, de patience et de compréhension.
Vitesse contre compréhension : un apprentissage en surface
L’école française souffre d’une obsession quantitative qui sacrifie la qualité sur l’autel de la performance chiffrée. L’exemple de la lecture en CP illustre parfaitement cette dérive : l’institution fixe des objectifs en nombre de mots lus par minute, sans se préoccuper de la compréhension réelle du texte.
Cette approche révèle une incompréhension fondamentale de l’apprentissage. Comme le souligne une mère de famille : « Je me fiche du nombre de mots que ma fille arrive à lire, ce que je souhaite, c’est qu’elle comprenne ce qu’elle lit ». Un enfant qui déchiffre rapidement sans saisir le sens ne développe pas une vraie relation avec la lecture.
Les mathématiques subissent le même traitement. L’école enseigne des formules abstraites sans jamais faire le lien avec la vie quotidienne. Pourquoi apprendre les tables de multiplication ? Pour calculer les distances de sécurité au permis de conduire, rendre la monnaie, doser un médicament… Mais ces explications concrètes sont rarement données.
Cette perte du sens explique en partie pourquoi tant d’adultes français conservent des lacunes béantes malgré leurs années d’études. L’école a privilégié l’accumulation de connaissances parcellaires au détriment de la construction d’une compréhension globale et durable.
Regards internationaux sur l’enseignement et l’égalité des chances

Quand certains pays réduisent les inégalités sociales par l’éducation
Malgré la démocratisation apparente de l’enseignement supérieur, les inégalités sociales demeurent criantes. Le rapport OCDE 2025 révèle que les enfants de parents diplômés conservent un avantage considérable dans leur parcours éducatif. En France, 75% des 25-34 ans dont au moins un parent est diplômé obtiennent un diplôme de l’enseignement supérieur, contre seulement 32% pour ceux dont les parents n’ont pas terminé le secondaire.
Cette reproduction sociale s’explique par de multiples facteurs. Les familles diplômées maîtrisent mieux les codes scolaires et peuvent accompagner leurs enfants dans leurs études. Elles disposent également de réseaux professionnels et de moyens financiers facilitant la poursuite d’études longues.
L’écart se creuse dès les compétences de base. Selon l’enquête PIAAC de l’OCDE 2023, les adultes diplômés du supérieur obtiennent en moyenne un score supérieur de 47 points en littératie par rapport aux non-diplômés – un écart plus important que la moyenne OCDE (34 points). Cette différence témoigne d’un système qui amplifie les inégalités plutôt que de les corriger.
Plus inquiétant encore, même parmi les diplômés du secondaire, 36% ont un niveau faible en littératie en France (contre 30% en moyenne OCDE). Ces chiffres soulignent que l’accès à l’éducation ne garantit pas l’acquisition de compétences solides et durables.
Leçons tirées des modèles éducatifs étrangers (Danemark, Corée, Royaume-Uni)
Les comparaisons internationales révèlent que cette fatalité sociale n’est pas une loi immuable. Certains pays ont réussi à réduire significativement l’impact de l’origine sociale sur la réussite éducative.
Le Danemark et la Corée font figure de modèles avec 40% de chances d’obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur même si les parents n’ont pas terminé leurs études secondaires. Ces pays ont mis en place des politiques volontaristes d’égalité des chances : bourses généreuses, accompagnement renforcé, orientation précoce.
À l’inverse, la Hongrie et la Lituanie affichent des taux dramatiquement bas de 7% seulement. Ces exemples contrastés démontrent que les politiques publiques peuvent influer significativement sur la mobilité sociale par l’éducation.
Andreas Schleicher souligne que le système britannique de prêts étudiants se révèle plus égalisateur que certains pays où l’État finance davantage les études supérieures. Le remboursement conditionné au niveau de rémunération atteint permet d’éviter l’autocensure des familles modestes tout en responsabilisant les étudiants.
Ces expériences internationales prouvent qu’il est possible de concilier excellence et égalité des chances, à condition de repenser fondamentalement l’architecture du système éducatif et ses mécanismes de financement.
L’éducation et ses enjeux économiques selon l’OCDE

Diplômes et emploi : plus-value salariale mais inadéquation des compétences
L’investissement dans l’éducation conserve une rentabilité économique indéniable, malgré les dysfonctionnements du système. Selon l’OCDE, une licence rapporte 39% de plus qu’un diplôme de l’enseignement secondaire, et cette plus-value augmente encore avec un master. Cette réalité économique explique en partie l’engouement persistant pour les études supérieures.
En France, les écarts de chômage selon le niveau de diplôme restent significatifs. En 2024, 18,5% des jeunes adultes sans diplôme sont au chômage, contre 9,9% pour ceux avec un diplôme du secondaire et 6,3% pour les diplômés du supérieur. Ces chiffres, plus élevés que la moyenne OCDE, soulignent l’importance cruciale du diplôme sur le marché du travail français.
Cette plus-value économique alimente une mobilité étudiante internationale croissante. Les étudiants sont prêts à investir massivement dans leur formation, y compris à l’étranger, conscients des retombées financières à long terme. Le phénomène s’amplifie malgré l’augmentation des coûts de formation dans de nombreux pays.
Paradoxalement, cette attractivité économique des études supérieures masque les défaillances du système. Les entreprises continuent de recruter sur la base du diplôme, perpétuant un cercle vicieux où le niveau requis s’élève constamment sans garantie d’amélioration des compétences réelles.
L’enseignement français face aux défis technologiques et aux formations courtes certifiantes
L’émergence de l’intelligence artificielle et la transition écologique transforment radicalement les besoins en compétences. L’OCDE recommande la généralisation des formations courtes certifiantes tout au long de la vie active pour permettre aux travailleurs de s’adapter à ces mutations profondes.
Cette révolution technologique révèle l’inadéquation entre les formations dispensées et les besoins économiques réels. 40% des employeurs déclarent être en pénurie de compétences, un paradoxe dans un contexte d’inflation diplômante. Les entreprises recherchent des profils polyvalents et adaptatifs que le système éducatif traditionnel peine à former.
L’exemple français illustre cette déconnexion croissante. Alors que le pays forme massivement en commerce et gestion, les secteurs scientifiques et techniques peinent à attirer les étudiants. Cette orientation préférentiellement tertiaire contraste avec les besoins industriels et technologiques de l’économie du XXIe siècle.
L’OCDE insiste sur la nécessité de repenser la formation continue. Les compétences acquises en formation initiale deviennent rapidement obsolètes dans un monde en mutation permanente. Seule une logique d’apprentissage tout au long de la vie permettra aux travailleurs de maintenir leur employabilité face aux défis technologiques et environnementaux émergents.
Approche parentale alternative : redonner du sens à l’apprentissage

L’importance du “pourquoi” dans l’enseignement selon les parents
Face aux dysfonctionnements du système, certains parents développent une approche alternative qui remet le sens au cœur des apprentissages. L’exemple de cette mère de famille illustre parfaitement cette démarche : quand sa fille ramène un 10/20 en mathématiques, la première question n’est pas de culpabiliser mais de comprendre.
« Est-ce que tu penses avoir fait ton mieux ? Est-ce que tu sais ce que signifie ce 10/20 ? » Cette approche constructive transforme l’échec en opportunité d’apprentissage. Plutôt que de dramatiser la note, elle explique que la leçon n’est simplement pas encore bien intégrée, et que c’est normal et surmontable.
Cette philosophie éducative s’oppose radicalement à l’obsession scolaire des résultats chiffrés. Au lieu de se focaliser sur la performance, elle privilégie la compréhension profonde et l’acquisition durable des savoirs. Une démarche qui rejoint les constats de l’OCDE sur la nécessité de privilégier la qualité sur la quantité.
L’exemple des mathématiques révèle toute la richesse de cette approche. Plutôt que d’imposer l’apprentissage des tables de multiplication sans explication, cette mère contextualise chaque notion. « Pourquoi c’est important de connaître les multiplications ? Ça te servira pour le permis, pour calculer les distances de sécurité. Si tu roules à 60 km/h et que tu ne sais pas faire 6 fois 6, comment calculer ta distance de freinage ? »
Cette pédagogie du sens donne une utilité concrète aux apprentissages abstraits. L’enfant comprend que les mathématiques ne sont pas une contrainte arbitraire mais un outil indispensable pour naviguer dans la vie quotidienne : rendre la monnaie, doser un médicament, bricoler, gérer un budget.
Responsabiliser les enfants sans les culpabiliser
L’approche de cette mère révèle une subtilité pédagogique remarquable : elle distingue clairement les situations où l’enfant n’a pas fourni l’effort nécessaire de celles où les difficultés relèvent d’autres facteurs. Cette nuance, trop souvent absente du système scolaire, permet de responsabiliser sans détruire.
Quand l’enfant n’a manifestement pas travaillé, la sanction est claire mais expliquée : « Tu as eu cette note parce que tu n’as pas fait ton mieux. La prochaine fois, maman ne pourra pas te laisser autant de temps libre. Pas parce que je ne t’aime pas, mais parce que la confiance se gagne. » Une logique de conséquences naturelles qui enseigne la responsabilité personnelle.
À l’inverse, quand l’enfant a fourni les efforts mais rencontre des difficultés, l’approche change radicalement. L’accent se porte alors sur la recherche de solutions : changer de méthode, relire ensemble, demander de l’aide à l’enseignant. L’objectif n’est plus de sanctionner mais d’accompagner et d’adapter.
Cette philosophie s’étend même aux situations où l’enseignant peut se tromper. Plutôt que de dénigrer l’institution, cette mère enseigne à sa fille une leçon de vie précieuse : « Parfois dans la vie, on n’est pas évalué justement. Ce n’est pas grave, ça fait partie de l’existence. L’important, c’est d’être un peu plus malin la prochaine fois. »
Cette approche prépare l’enfant aux réalités du monde adulte où justice et équité ne sont pas toujours au rendez-vous. Elle développe résilience et capacité d’adaptation, compétences cruciales que l’école traditionnelle néglige trop souvent au profit de la conformité passive.
Les recommandations du rapport OCDE 2025 pour l’avenir

Miser sur la littératie, les filières techniques et les formations certifiantes
Face aux dysfonctionnements identifiés, l’OCDE formule des recommandations pragmatiques pour refonder le système éducatif. La généralisation des formations courtes certifiantes tout au long de la vie active constitue l’axe principal de cette transformation. Cette approche vise à combler le fossé entre les compétences enseignées et les besoins réels des entreprises.
L’organisation préconise un investissement massif dans les compétences de base, particulièrement en littératie et numératie. Les données révèlent que 30% des adultes français n’atteignent pas le niveau de lecture d’un élève de primaire, un handicap majeur dans une économie de la connaissance. Cette priorité suppose de réviser fondamentalement les méthodes pédagogiques pour privilégier la compréhension sur la rapidité.
L’OCDE insiste également sur la nécessité de revaloriser les filières scientifiques et techniques. Alors que les enjeux climatiques et technologiques dominent l’agenda économique, la France continue de former massivement en commerce et gestion. Cette inadéquation met en péril la compétitivité future du pays et sa capacité d’innovation.
Enfin, l’organisation recommande une approche différenciée selon les profils d’apprenants. Le modèle unique qui impose le même rythme à tous les élèves montre ses limites. Seule une pédagogie adaptative et personnalisée permettra de réduire les inégalités tout en maximisant le potentiel de chacun.
Réconcilier familles et enseignants pour une école française plus forte
Au-delà des recommandations institutionnelles, la reconstruction du lien famille-école apparaît comme un préalable indispensable. Cette mère de famille témoigne de son inquiétude : « Je suis très inquiète pour l’avenir quand je vois les adultes de notre génération. Alors je suis un peu pessimiste pour nos enfants, mais je reste optimiste en cherchant des solutions. »
Cette collaboration suppose un changement de paradigme de part et d’autre. Les enseignants doivent retrouver confiance en leur mission pédagogique et accepter le dialogue avec les familles. Les parents doivent comprendre que critiquer systématiquement l’école dessert leurs enfants et mine l’autorité éducative.
L’exemple de cette mère illustre l’équilibre à trouver : soutenir l’enseignant quand la note est justifiée, tout en gardant un esprit critique constructif quand la situation l’exige. « Le maître a eu raison de te donner cette note, pas parce que tu es bête, mais parce que tu n’as pas fait le nécessaire. » Cette approche restaure la légitimité de l’évaluation tout en préservant l’estime de soi de l’enfant.
La formation des futurs citoyens exige cette alliance éducative. Comme le souligne cette mère : « Toute situation qu’on vit enfant, on la vivra adulte. Les enfants d’aujourd’hui, ce sont les futurs citoyens. » Cette responsabilité partagée suppose de dépasser les querelles d’ego pour se concentrer sur l’essentiel : transmettre les clés d’un avenir épanouissant.
Conclusion : réinventer l’enseignement français pour dépasser les inégalités sociales

Le rapport OCDE 2025 révèle l’ampleur de la crise éducative française, mais aussi les voies de sortie possibles. Entre inflation diplômante et stagnation des compétences, entre reproduction sociale et perte du sens, l’école française doit retrouver sa mission première : former des citoyens éclairés et compétents.
L’approche de cette mère de famille montre qu’une alternative est possible. En privilégiant la compréhension sur la performance, le sens sur la rapidité, la responsabilisation sur la culpabilisation, elle trace une voie qui concilie excellence et bienveillance. Une pédagogie du « pourquoi » qui redonne aux apprentissages leur utilité concrète et leur dimension humaine.
L’enjeu dépasse les frontières nationales. Dans un monde en mutation permanente, seuls les systèmes éducatifs capables de s’adapter et d’innover prépareront efficacement les générations futures. La France dispose des atouts pour relever ce défi, à condition de réconcilier enfin quantité et qualité, tradition et modernité, institution et familles.
Découvrez aussi nos autres univers
Vous en voulez encore ?
Bonne nouvelle : notre blog ne manque pas d’idées pour alléger votre quotidien !
- Atypique : un espace dédié à la neurodiversité et au handicap, avec des infos claires et fiables pour mieux comprendre et accompagner nos enfants singuliers.
- Bien-être : conseils et astuces pour les mamans qui veulent se sentir bien, rester belles au quotidien et prendre soin d’elles sans culpabilité.
- Nutrition : recettes rapides, menus de saison, astuces anti-gaspi et idées futées pour nourrir toute la famille avec une alimentation saine et équilibrée.
- Parentalité : histoires vraies, réflexions et petits ratés qui deviennent de grands souvenirs.
- Santé : prévention, suivi, bien-être du corps et de l’esprit : des infos claires, pratiques et mises à jour pour prendre soin de toute la famille en toute confiance.
Un peu d’inspiration, beaucoup de partage, et surtout l’envie de rendre chaque jour plus léger.
Si cet article vous a plu, pensez à le partager avec vos proches et retrouvez-nous aussi sur nos réseaux !


