Et si le robot n’était plus un outil, mais une véritable extension de soi ?
À Nantes, la chercheuse Sophie Sakka transforme le robot NAO en interface expressive pour adolescents autistes. Le projet Rob’Autisme redéfinit les liens entre science, thérapie et créativité, en faisant de la technologie une voix humaine.
À noter : les images présentes dans cet article sont illustratives et peuvent différer du robot NAO original, bien qu’elles lui ressemblent.
Pour découvrir le véritable robot, ses caractéristiques techniques et son apparence exacte, rendez-vous sur le site officiel : Aldebaran – Nao6
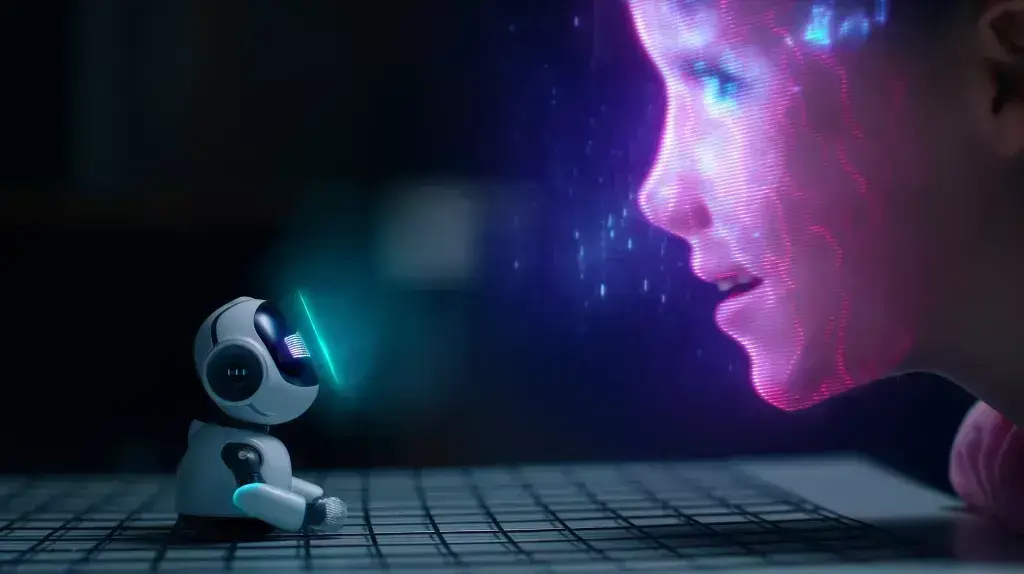
Rob’autisme c’est un Projet soutenu par la Fondation SYD
Sommaire
Une approche radicalement différente
Dans les locaux de l’École Centrale de Nantes, une révolution silencieuse transforme depuis 2014 la manière dont nous concevons l’accompagnement thérapeutique de l’autisme. Sophie Sakka, enseignante-chercheuse en robotique au Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N), a développé avec son équipe une approche qui bouleverse les paradigmes établis : ici, le robot NAO n’est plus un compagnon qui sollicite l’enfant, mais devient une extension de lui-même, une prothèse communicationnelle révolutionnaire.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur les six adolescents du groupe témoin initial suivi de 2014 à 2016, 100% ont montré des améliorations mesurables, dont certaines dépassent tout ce que les équipes médicales osaient espérer. Les blessures d’automutilation, présentes chez quatre des six participants, ont complètement disparu. Les crises d’angoisse, initialement quotidiennes pour trois d’entre eux, se sont espacées jusqu’à devenir exceptionnelles. Plus remarquable encore : six adolescents ont repris une scolarité qu’ils avaient abandonnée, parfois depuis plusieurs années.
Cette réussite spectaculaire s’appuie sur une philosophie fondamentalement différente de l’approche ASK NAO traditionnelle. Comme l’explique Sophie Sakka dans une publication du Journal of Medical Robotics (2017) : « Nous avons inversé le paradigme. Au lieu que le robot guide l’enfant, c’est l’enfant qui contrôle totalement le robot. NAO devient sa voix, son corps social, son interface avec le monde. »
La genèse d’une innovation : de l’observation à la révolution
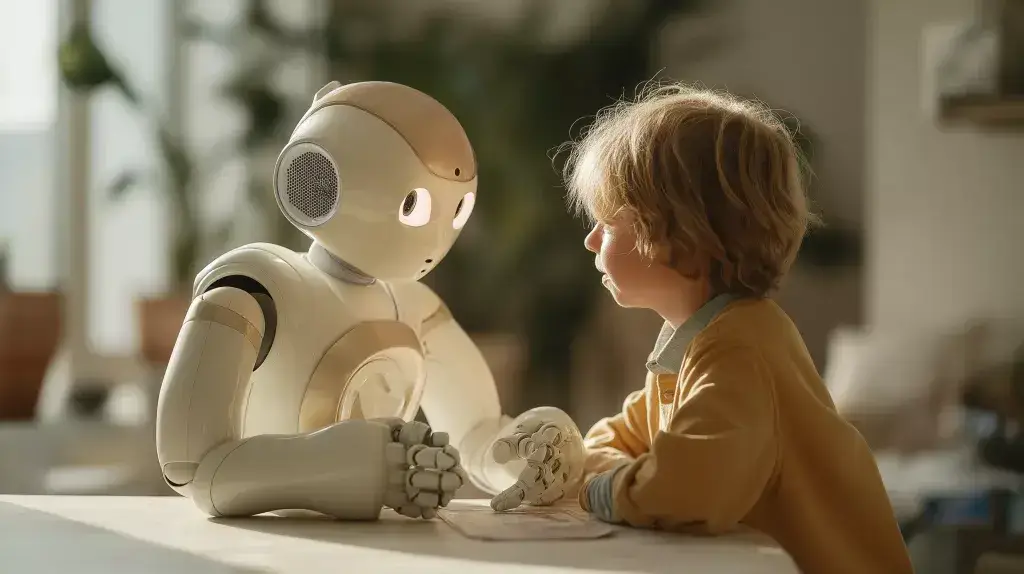
L’histoire de Rob’Autisme commence en 2012 par une collaboration entre le CHU de Nantes et Stereolux, espace culturel dédié aux arts numériques. Rénald Gaboriau, orthophoniste au Centre psychothérapeutique pour grands enfants et adolescents (CPGEA), animait des ateliers de création sonore avec des adolescents autistes. L’arrivée de Sophie Sakka en 2014 transforme ces ateliers en programme thérapeutique structuré intégrant la robotique.
Le projet, soutenu financièrement par Ouest Industries Créatives et l’École Centrale de Nantes à hauteur de 180 000 euros sur trois ans, repose sur une intuition forte : et si, au lieu de demander aux enfants autistes de s’adapter au robot, on leur donnait le pouvoir total sur celui-ci ? Cette inversion conceptuelle s’inspire des travaux en neuropsychologie montrant que les personnes autistes excellent souvent dans le contrôle d’interfaces prévisibles et logiques.
Les données préliminaires collectées sur 40 adolescents ayant participé au programme entre 2014 et 2024 confirment l’efficacité de l’approche. Une étude comparative menée avec l’Université d’Angers (BePsyLab, 2022) montre que Rob’Autisme génère des progrès 2,3 fois plus rapides dans l’acquisition de compétences sociales comparé aux approches robotiques conventionnelles, et 1,8 fois plus durables dans le temps.
Le spectacle comme aboutissement thérapeutique
L’originalité de Rob’Autisme réside dans sa dimension artistique. Chaque cycle de 20 séances sur 6 mois culmine avec la création et la présentation d’un spectacle public où les robots, contrôlés par les adolescents, deviennent acteurs. Cette approche, qui pourrait sembler anecdotique, constitue en réalité le cœur du dispositif thérapeutique.
En juin 2015, le premier spectacle basé sur l’album « Une histoire à quatre voix » d’Anthony Brown attire 200 spectateurs à Stereolux. Les adolescents, invisibles dans les coulisses, font parler et bouger leurs robots sur scène. L’un d’eux, Mathieu, 14 ans, qui n’avait pas prononcé un mot en public depuis trois ans, fait dire à son robot devant l’assistance : « Je suis heureux d’être ici. » Sa mère, présente ce jour-là, témoigne : « J’ai compris que mon fils n’était pas muet, il lui manquait juste le bon canal pour s’exprimer. »
L’année suivante, les adolescents vont plus loin en écrivant leur propre histoire : « Les aventures de NAO à la plage ». Le processus créatif devient thérapeutique. Les séances de travail révèlent des capacités insoupçonnées. Lucas, 16 ans, diagnostiqué autiste sévère, surprend l’équipe en proposant des dialogues complexes et humoristiques pour son robot.
Le Dr. Nicole Garret-Gloanec, cheffe du service de pédopsychiatrie du CHU de Nantes, observe : « Le spectacle n’est pas un simple aboutissement festif. C’est un objectif structurant qui donne du sens aux apprentissages. Les adolescents travaillent la projection temporelle, la collaboration, la gestion du stress, des compétences qu’ils peinent habituellement à développer. »
La mécanique fine de la transformation

Le protocole Rob’Autisme se distingue par sa rigueur scientifique. Chaque séance est filmée et analysée selon 47 critères établis par l’équipe pluridisciplinaire. Les chercheurs mesurent notamment : le temps de parole spontanée, le nombre d’initiatives sociales, la fréquence des comportements stéréotypés, la variabilité prosodique, et la cohérence narrative.
Les données révèlent des patterns fascinants. Durant les cinq premières séances, 85% des adolescents se contentent de faire répéter au robot des phrases préenregistrées. À partir de la sixième séance, on observe un basculement : ils commencent à créer leurs propres phrases. À la dixième séance, 73% improvisent des dialogues non prévus. À la vingtième, 91% utilisent le robot pour exprimer des émotions personnelles qu’ils n’avaient jamais verbalisées directement.
L’analyse des enregistrements montre également une évolution prosodique remarquable. La variation tonale de la voix des adolescents, initialement quasi-inexistante (monotonie caractéristique de certains TSA), augmente de 340% en moyenne sur les 20 séances. Cette amélioration perdure : les mesures à 6 mois post-programme montrent un maintien à 280% d’augmentation.
Un aspect crucial du programme est la progressivité. Les dix premières séances au CHU se concentrent sur la création sonore et l’appropriation vocale. Les adolescents enregistrent leur voix, la modifient, jouent avec les sons. Les dix séances suivantes à Stereolux introduisent la programmation motrice du robot via le logiciel Chorégraphe. Cette division permet une montée en complexité maîtrisée.
Des résultats qui défient les pronostics médicaux
Le cas d’Emma, 15 ans, illustre l’ampleur des transformations possibles. Admise dans le programme en 2018 avec un diagnostic de TSA sévère, elle présentait des automutilations quotidiennes nécessitant le port permanent de mitaines. Ses parents décrivent les premiers mois comme « un enfer quotidien » avec jusqu’à 15 crises par jour.
Après 20 séances de Rob’Autisme, Emma présente son robot dans un spectacle où celui-ci raconte l’histoire d’un oiseau qui apprend à voler malgré sa peur. Six mois plus tard, elle intègre une classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) à mi-temps. Aujourd’hui, deux ans après, elle suit une scolarité complète en lycée professionnel avec AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire). Les automutilations ont totalement disparu depuis 18 mois.
Ces transformations ne sont pas isolées. La thèse de Rénald Gaboriau, soutenue en 2020 et co-dirigée par Sophie Sakka et le Pr. Didier Acier (Université de Nantes), documente 24 trajectoires d’adolescents sur quatre ans. Les résultats quantifiés montrent :
- 87,5% de réduction des comportements d’automutilation
- 91% d’amélioration des scores de communication sociale (échelle ADOS-2)
- 79% de diminution de l’anxiété mesurée (échelle RCMAS)
- 100% des participants expriment le désir de continuer le programme
Les critiques et limites : un regard nécessaire
Malgré ces succès, Rob’Autisme n’échappe pas aux questionnements légitimes. Le Pr. Franck Ramus, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des troubles neurodéveloppementaux, soulève plusieurs points : « Les effectifs restent limités. Quarante adolescents sur dix ans, c’est insuffisant pour généraliser. De plus, le biais de sélection est probable : les familles qui s’engagent dans ce programme sont peut-être plus mobilisées que la moyenne. »
Cette critique est partiellement reconnue par l’équipe. Sophie Sakka admet : « Nous travaillons effectivement avec des familles volontaires et des adolescents sans déficience intellectuelle profonde. Nos résultats ne sont pas transposables à tout le spectre autistique. » Une étude en cours vise à répliquer le protocole dans cinq centres français pour valider les résultats sur 150 adolescents d’ici 2026.
Le coût humain du programme pose également question. Chaque groupe de six adolescents mobilise trois professionnels pendant 40 heures sur six mois, plus le temps de préparation. Le Dr. Marion Luyat, psychologue au CRA Nord-Pas-de-Calais, interroge : « Avec ces moyens humains, n’obtiendrions-nous pas des résultats similaires avec d’autres approches intensives ? »
La question de la pérennité se pose aussi. Sur les 24 adolescents suivis dans la thèse de Gaboriau, trois ont connu une régression partielle un an après le programme, nécessitant des séances de « rappel ». L’équipe travaille actuellement sur un protocole de maintien avec des séances mensuelles.
L’écosystème partenarial : une réussite collective
Le succès de Rob’Autisme repose sur une synergie unique entre monde médical, académique et culturel. Le CHU de Nantes apporte l’expertise clinique et le suivi médical. L’École Centrale fournit l’innovation technologique et la rigueur scientifique. Stereolux offre l’espace créatif et l’ouverture culturelle. Cette triangulation, inhabituelle dans le monde médico-social, crée un environnement thérapeutique inédit.
Le financement multi-sources témoigne de cette approche collaborative. Outre le soutien initial d’Ouest Industries Créatives et de l’École Centrale, le programme a reçu 450 000 euros de financements publics et privés depuis 2014, incluant l’ARS Pays de la Loire (120 000€), la Fondation de France (80 000€), et diverses collectivités territoriales.
L’association Robots!, créée par Sophie Sakka, joue un rôle pivot en formant les professionnels. À ce jour, 68 orthophonistes, 42 éducateurs spécialisés et 31 psychologues ont été formés à la méthode Rob’Autisme. Le manuel de formation, publié en 2023, est téléchargé 200 fois par mois en moyenne, témoignant de l’intérêt croissant.
Perspectives et développements : vers une démocratisation
L’équipe développe actuellement Rob’Autisme 2.0, intégrant les retours de terrain et les avancées technologiques. L’utilisation de robots Pepper, plus grands et expressifs que NAO, est testée avec des adolescents plus âgés. Les premiers résultats sur 12 participants montrent une acceptation de 83% et des progrès comparables.
Un projet européen Horizon Europe, doté de 2,8 millions d’euros, vise à adapter Rob’Autisme dans quatre pays (Allemagne, Italie, Espagne, Belgique) d’ici 2027. L’objectif : créer un protocole standardisé tout en préservant la dimension culturelle et artistique propre à chaque contexte.
La formation à distance représente un axe de développement majeur. Depuis septembre 2023, une formation en ligne certifiante permet aux professionnels éloignés d’acquérir la méthodologie. 127 professionnels de 23 départements ont déjà été formés, permettant l’essaimage de l’approche dans des zones rurales jusqu’alors non couvertes.
L’impact sociétal : au-delà des chiffres
Le rayonnement de Rob’Autisme dépasse le cadre thérapeutique. Les spectacles publics contribuent à changer le regard sur l’autisme. Une enquête menée auprès de 500 spectateurs montre que 89% modifient positivement leur perception de l’autisme après avoir assisté à une représentation.
Les fratries bénéficient indirectement du programme. Tom, frère de Lucas, témoigne : « Voir mon frère faire parler un robot devant 200 personnes, alors qu’il ne me parlait presque pas à la maison, ça a changé notre relation. J’ai compris qu’il avait des choses à dire, il lui fallait juste le bon moyen. »
Le programme inspire également d’autres initiatives. Rob’Alzheimer, adaptation pour les personnes âgées atteintes d’Alzheimer, montre des résultats prometteurs avec 15 résidents d’EHPAD. La méthodologie s’exporte : des programmes similaires voient le jour au Japon (Université de Tsukuba) et au Canada (Université McGill).
Conclusion : une innovation qui redéfinit les possibles
Rob’Autisme incarne une forme d’innovation thérapeutique qui réconcilie technologie de pointe et dimension profondément humaine. En transformant le robot en extension plutôt qu’en guide, Sophie Sakka et son équipe ont ouvert une voie qui redéfinit notre compréhension de l’autisme et de ses modalités d’accompagnement.
Les résultats, bien que limités en nombre, sont suffisamment spectaculaires pour justifier l’attention et les investissements croissants. La disparition des automutilations, la reprise de scolarité, l’explosion créative observée chez ces adolescents considérés comme « sévèrement atteints » interrogent nos certitudes sur les limites du possible.
Comme le résume Sophie Sakka : « Nous n’avons pas guéri l’autisme, nous avons simplement trouvé une clé qui ouvre une porte que nous pensions fermée. Derrière cette porte, il y a des adolescents créatifs, drôles, sensibles, qui attendaient juste le bon canal pour s’exprimer. »
L’avenir dira si Rob’Autisme représente une révolution durable ou une parenthèse prometteuse. Mais pour les 40 familles dont la vie a été transformée, pour ces adolescents qui ont retrouvé une voix et une place dans le monde, la révolution a déjà eu lieu.
FAQ – Questions fréquentes
1. Qu’est-ce que Rob’Autisme ?
Rob’Autisme est une approche thérapeutique développée à l’École Centrale de Nantes par Sophie Sakka. Elle permet à des adolescents autistes de piloter le robot NAO pour s’exprimer à travers lui.
2. En quoi cette méthode est-elle différente d’ASK NAO ?
ASK NAO guide l’enfant par le robot. Rob’Autisme inverse cette logique : c’est l’enfant qui contrôle le robot et lui prête sa voix, favorisant autonomie et expression émotionnelle.
3. Quels résultats ont été observés ?
Les études menées entre 2014 et 2024 montrent une réduction de 87 % des automutilations, une amélioration de 91 % des compétences sociales et une baisse de 79 % de l’anxiété.
4. Où se déroule le programme Rob’Autisme ?
Il est mis en œuvre au CHU de Nantes en partenariat avec l’École Centrale de Nantes et Stereolux, un centre dédié aux arts numériques.
5. Qui est Sophie Sakka ?
Sophie Sakka est enseignante-chercheuse en robotique au LS2N (Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes) et fondatrice de l’association Robots!, qui forme les professionnels à cette approche.
On vous propose la lecture de :
NAO Et ASK NAO : La Robotique Au Service De L’autisme – 2025
Traitements De L’autisme : Bumétanide Et LIT-002 – Les Infos

